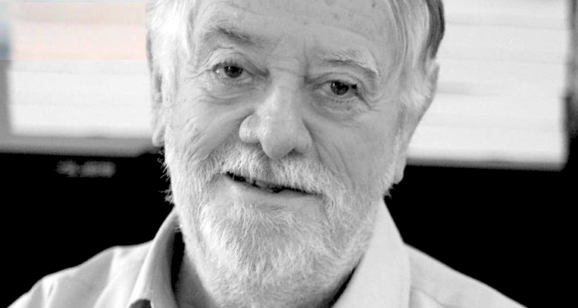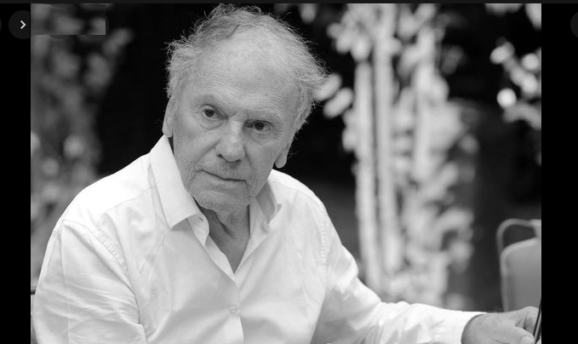…pour un certain temps à ce nom dont la présence de deux patronymes (et d’un prénom rare dans le monde politique) constituent déjà une source de bafouillage pour certains journalistes (c’est moins ‘évident’ que Ferrand). Mais pas de panique, tout cela est très facile à analyser, même si l’attelage des deux mots de l’Etat-civil est un peu inattendu.
En fait, Braun et Pivet n’ont rien à voir l’un avec l’autre si ce n’est l’adoption du nom de son mari Vianney ajouté à celui de son ascendance familiale de provenance juive polonaise…Commençons donc par ce ‘Braun’ ou plutôt braun communément puisque, dans toute la zone germanique, il désigne depuis des siècles une personne (et parfois un animal, puis un objet) de couleur ‘brune’ soit, dans le langage commun, marron en français.
Au départ, il s’agit le plus souvent de la couleur des cheveux, nos ancêtres connaissant grosso-modo trois options de teinture (naturelle) soit brun-blond-rouge (roux) et on faisait avec, chaque nuance ayant, au cours des siècles et selon la culture locale, un certain nombre de symboles: pour le rouge (à éviter), plutôt la couleur du diable; pour le blond (bonne pioche), le soleil et la brillance; pour le brun, souvent la nature et/ou la force.
Dans ce dernier cas, outre l’évolution du brun-marron en ‘bronzé’ pour désigner non pas les peuples « du sud » mais les gens exposés au soleil (les paysans), le brun est emprunté au latin ‘brunus’ – qui va donner braun en allemand et brown en anglais – et il évoque à l’origine non seulement une peau mate puis des cheveux foncés mais aussi des poils et même un poil brillant. De fait, pour les peuples germaniques, le colosse qui a des poils marron et brillant est forcément le personnage qui les hante en permanence soit l’ours des forêts, lequel sera prénommé dans la majorité des contes français…Bruno (Lebrun)!
L’adjectif aura d’ailleurs un grand succès dans ce monde germanique puisqu’il donnera naissance, outre la forme simple Braun (comme l’ingénieur allemand émigré aux USA Werner Von Braun, sans lequel la NASA n’existerait peut-être pas), à des Braunberg ou Braunberger (l’habitant d’une ‘montagne brune’ au sens de sombre, donc peu ou pas exposée au soleil), à des Branhaus ou Braunhauser (brown-house en anglais, la ‘maison brune’ c’est-à-dire en pierre), des Braunstein (pierres brunes, soit carrément cette fois un château) et enfin des Braunhar (brown-hair), surnom…religieux qui fait allusion au personnage biblique de Samson, dont la chevelure était la force et qui était un peu ‘blonde’ quand il roupillait au mauvais moment.
Quant à ‘Pivet’, il peut lui aussi avoir plusieurs significations, selon la région de provenance. Il existe un certain nombre de micro-étymologies locales spécifiques, comme une éventuelle déformation de ‘pivot’, au sens énigmatique de pointe ou attache de mouvement, uniquement explicable par une activité ou un symbole propre. D’autres, un tout petit peu plus fréquentes, renvoient à la ‘pive’, le nom savoyard de la pomme de pin, ou au ‘pivol’, nom régional du peuplier…
Le plus largement répandu est en réalité une orthographe de Piver donc…pivert, nom de l’oiseau dont on a gratifié un ancêtre concerné par le volatile en question (reste à savoir pourquoi). La tradition onomastique (des noms de famille) a en effet fréquemment surnommé quelqu’un qui habitait dans l’environnement, pratiquait la chasse, imitait le cri ou portait les couleurs de ces oiseaux. Pour les mêmes raisons, on trouve des familles Loiseau (évident) mais aussi des Lemerle, des Rossignol, des Serin, etc…
Petite parenthèse: au sens figuré, tout comme les Serin (serein?) ont pu prendre le sens de rêveurs voire de lunatiques, le Pivert du Moyen-Age qualifiait – ça a changé depuis – des…’lourdauds’, semble-t-il à cause des nuisances sonores que faisait un homme maladroit en faisant tomber des objets. N’extrapolons pas sur la couleur rouge de la tête qui pourrait évoquer divers symptômes, d’autant que si le pivert est en fait un pic-vert, il est bien vert de plumage mais pas du tout piqueur de ramage, même s’il tape sur les troncs d’arbre!
C’est en fait une déformation d’une pie-verte (l’oiseau voleur d’objets brillants se dit ‘pica’ en latin), il s’agit donc d’une ‘pie verte’, tout simplement parce que nos Ancêtres n’avaient pas encore de nomenclatures animales très développées; on regroupait beaucoup par apparences: c’était pareil pour les chèvres (boucs, bouquetins, chamois, etc), les vaches (boeufs, veaux, taureaux, zébus voire chameaux); tout comme pour les fruits, globalement appelés pommes selon leur provenance (de Turquie, de Malte, de Crète, d’Egypte, etc) et ne désignant pas du tout la production du pommier mais des melons, des coings, des poires ou même, plus tard, des tomates.
Mais le plus intéressant du pivert est son aventure mythologique, puisqu’il était honoré par les Grecs et les Romains pour faire partie du Panthéon et donc de l’histoire divine de leurs religions. D’un point de vue symbolique, il était associé au dieu…Mars (dieu de la guerre!?) et, à ce titre, bénéficiait du même rang que le loup; on dit d’ailleurs que c’est un pivert qui assistait la Louve romaine pour nourrir (d’insectes?) Romulus et Rémus, par ailleurs fils jumeaux du dieu cité.
Dans d’autres points du globe, les tribus indiennes d’Amérique du Nord, peu suspectes d’avoir échangé par sms avec les précédents, considéraient le pivert comme « l’oiseau de la sécurité », capable de (je cite) « détourner les désastres que sont la tempête et la foudre », ce qui explique(rait) la présence abondante de plumes vertes dans leurs coiffures, prouvant ainsi que le pivert est apparemment peu capable d’assurer sa propre sécurité…
Même le spécialiste suisse de la ‘métapsychologie’, un certain Carl Yung psychiatre de son état, avait étudié le pivert comme (re-citation) « symbole de l’enfantement et de la rentrée vers la mère » (le fait que le bec du pivert veuille pénétrer l’arbre!), cette action illustrant « la force libératrice de la pensée ». Voilà qui pourra peut-être inspirer les prises de parole des député(e)s lors des séances de l’Assemblée sous la direction de la nouvelle Présidente. Au moins étymologiquement!