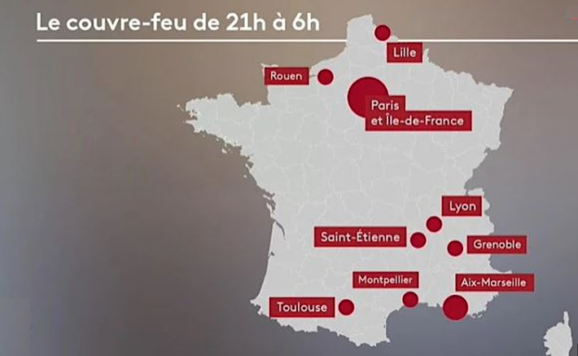…en tous cas l’impression générale des médias français (et autres) à la lecture, qui aura été très floue, des premiers résultats du vote destiné à élire le successeur de D. Trump. Le mot est commun pour le citoyen français; il l’est moins pour beaucoup de nos amis francophones à travers le monde, de plus en plus présents dans les statistiques de fréquentation de ce blog (1).
Mais au fait, même si vous êtes né(e) à Romorantin (41), St Palais (64) ou La Bocca (06), savez-vous qu’à l’origine, le bazar n’avait pas du tout cette connotation de…’bordel’, qui définit si bien l’ambiance électorale américaine (ou sanitaire française) actuelle? Comme un certain -grand- nombre de mots français d’origine arabe, tel que ‘hasard’ (2), le bazar, autant d’un point de vue phonétique que linguistique, prend ses racines dans un Orient plutôt Moyen, d’après un ‘bâzââr’ arabe et même plus précisément perse.
Sans entrer dans trop de complications sémantiques, on a affaire, à l’origine, à un ‘bathzar’ qui arrive en Europe occidentale vers le 15ème siècle, d’abord timidement (pas d’Airbus Ankara-Paris) puis plus fréquemment au cours des siècles suivants, depuis la période des grandes modes orientalistes (« Le Bourgeois gentilhomme » de Molière, « Les Lettres Persanes » de Montesquieu, entre autres) jusqu’aux musiques de Mozart, Rossini, etc…
Ce futur bazar est encore bien rangé puisqu’il désigne alors un marché, non pas encore une halle avec ses boxes fleuriste-charcuterie-légumes bio, mais des étals à ciel ouvert (évidemment), sur une esplanade, un forum ou un carré où l’on vend principalement des étoffes et des accessoires, voire des bijoux…Ce n’est qu’au début du 18ème siècle que le bazar devient couvert, principalement à l’imitation de commerçants londoniens qui ont l’idée de regrouper plusieurs types de produits sous un même toit.
Avant de devenir une belle galerie marchande avec parfois avec des boutiques chics, ces premiers bazars, d’ailleurs souvent appelés ‘Grand Bazar’, vont donc être une sorte de foire(fouille) aux marchandises de relative (voire mauvaise) qualité, d’où le sens fourre-tout ou de ‘grand n’importe quoi’, le tout à des prix le plus bas possible.
Comme il n’est pas facile de remettre en ordre les étalages en permanence labourés par les client(e)s, le bazar va alors devenir un fourbi (3), voire un souk (sic), pour ne pas dire un…bataclan (4). Vous avez encore le choix avec un foutoir, un bric-à-brac ou un capharnaüm (re-sic); plus un certain nombre de termes propres aux militaires, dont le barda, le toutim, ou le fourniment pour le plus distingué.
Finalement, les seuls bazars bien en ordre seront célèbres pour des raisons commerciales (le Bazar de l’Hôtel de Ville), humanitaires (à l’origine, le Bazar de la Charité) ou…artistiques (le Big Bazar du chanteur Michel Fugain). Mais je ne voudrais pas mettre la pagaille dans votre esprit. Sauf étymologiquement!
(1) Hello Great-Britain, and…United States!
(2) « Al-zahr », devenu az-zahr’ puis hazar(d), désigne le jeu de dés; donc, par extension, ce qui arrive sur un coup…du sort. Voir aussi la chronique sur…le footballeur Eden (janvier 2011).
(3) A l’époque de Rabelais, le ‘fourby’ est un jeu de cartes où la confusion était destiné à perturber l’adversaire (une sorte de bonneteau).
(4) Voir les deux articles consacrés à la salle de spectacle parisienne (novembre 2016, puis juin 2020)