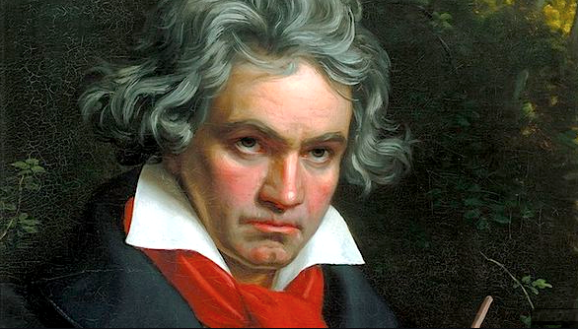…c’est le réalisateur américain d’origine italienne Quentin Tarantino, qui a annoncé que « The Movie Critic » (1) sera son dernier opus; l’homme n’est pas le cinquième d’un imbécile (quentin/quantin) car, en une dizaine de films, il a semé le trouble d’une certaine violence avec succès sur les écrans du monde entier…y compris étymologiquement!
Fils d’un certain Tony (Antoine, en v.f) Tarentino, lui-même déjà né à New-York de parents immigrés ‘latinos’ de la génération précédente, Quentin porte un nom de provenance tout à fait transparent puisqu’il fait référence à la grande ville du sud et même du ‘dessous’ de la Botte, le port en question étant situé (visuellement) dans le ‘cambrion’, la partie concave entre la pointe du talon et le bout de la chaussure, autrement dit au fond du golfe de…Tarente. Ou Tarante avec un ‘a’, ce qui est sa racine historique.
Il s’agit en effet d’une trouvaille géographique des Grecs où les bateaux se sont autrefois abrités lors de l’expansion de ce qu’on appelé « la Grande-Grèce », la colonie en question étant fondée en l’occurrence par des gens venus de Sparte. Est-ce un hasard ou en rapport avec le caractère belliqueux de la période? Le mot ‘taras’ en grec – qui donnera plus tard ‘tarantum’ pour les Romains est associé à la notion d’agitation ou de troubles (2).
Toujours est-il qu’au fil du temps la ville va donner son nom à un gentilé (les habitants qui en sont originaires) sous la forme de Tarantino, avec une nuance légèrement moqueuse des Romains (de Rome capitale) car le mot, outre venir du Sud ‘pauvre’, sonne comme avec un diminutif en -ino (3)…Rien à voir donc avec les habitant(e)s de la Tarentaise, région de la Savoie située à l’opposé du pays, qui s’appellent eux les Tarins et les Tarines (4).
Bref, notre Tarentin surdoué de cinéma vient truster dans l’esprit d’une bonne partie des habitants de la planète non seulement un patronyme porté par un certain Gaétan célèbre (en Belgique) graffeur (tagueur) impénitent, mais aussi le napolitain -logique- Luigi Tarentino, escrimeur multi-médaillé aux Jeux Olympiques (1998)…Signalons encore un nom commun cette fois, de même provenance, un type de danses sautillantes traditionnelles pratiquées dans les Pouilles et en Calabre, forcément nommées ‘tarentelles’ (5). Ou bien encore, dans le registre (très) littéraire, « la jeune Tarentine » prénommée Myrtho, dans le poème d’André Chénier (fin 18è siècle).
Le dernier (effrayant) dérivé cousin de notre Quentin est la…tarentule, une ‘tarentula’ dont la piqûre provoque (au mieux) des léthargies pénibles et dont on disait que sautiller comme si on dansait la tarentelle était le seul moyen de dissiper les effets du venin, d’où le nom! Il parait même que le nom de Tarantino a également été donné à des astéroïdes de l’orbite de Jupiter par les astronomes américains en raison des soubresauts incessants des mégalithes en question. Tout cela explique peut-être le caractère explosif des scénarios de Quentin; et que ça saute!
(1) En français (et pour l’instant) « Le/la critique de cinéma ».
(2) Il n’y avait pourtant pas d’aéroport en projet ni de méga-bassines à défendre dans le secteur…
(3) Par exemple, le nom local de Mickey Mouse est ‘topolino’ (le souriceau).
(4) Dans la langue française, je ne sais pas si c’est mieux…
(5) Si vous êtes né(e) avant 1980, (ré)écoutez la chanson d’Yves Duteil. Mais aussi Rossini, Chopin, Offenbach ou Bizet, parmi les plus fanas du tempo.