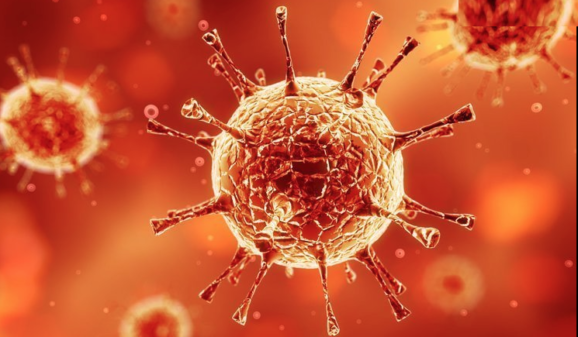
…même dans les recoins les plus anecdotiques du langage! On avait déjà dû perdre la pernicieuse habitude de nommer les virus par leur pays de provenance supposée (c’est pas sympa pour l’image du tourisme local) et donc plus question de laisser paraitre dans un média le terme de « virus chinois » (1), virus anglais, indien, brésilien ou même breton, la maladie, quelle qu’elle soit, étant le plus souvent le problème de l’étranger (grippe espagnole, asiatique, ‘mal italien’, ‘mal anglais’, etc au cours de l’Histoire).
Bref, cette fois-ci, l’Humanité a affaire à un mutant qui inquiète – à juste titre, sans doute – et que l’Organisation Mondiale de la Santé va donc enregistrer et lister sous une nomenclature qui épargne la susceptibilité des uns et des autres en adoptant le système de référencement le plus basique, l’alphabet. Mais comme on n’a pas tous le même (surtout qu’il va falloir oublier le chinois, l’arabe, le cyrillique, l’hindi, le coréen et pas mal d’autres joyeusetés graphiques), on a choisi le sérieux du vocabulaire médical à l’occidentale, le grec!
Souvent sollicité dès qu’il s’agit de sciences et techniques (la mission alpha, le béta-carotène, les gamma-globules, le delta-plane, le quotient epsilon, l’astéroïde zêta, etc…), on a donc appliqué la litanie des lettres grecques à la suite inquiétante des variants du virus de la Co-Vid 19 (2). Le premier à avoir remis les idées et surtout le générique en place est donc le variant Delta (ex-indien), qui aura un tel succès dans notre pays qu’il bénéficiera un ‘Delta +’ (mais pas ++ heureusement).
Suivront le variant epsilon (soit la lettre ‘e’ en grec, prononcez epsilonn pour ne pas avoir l’air plouc), ex-‘variant californien’; puis après une rafale d’intermédiaires parfois morts-nés de Zêta à Kappa dont vous avez peu entendu parler (entre autres, parce qu’il sont difficiles à dire ou peut-être qu’ils ne valaient pas un…iota), arrive le variant Lamba (ex-)péruvien, qui contrairement à ce que son surnom laisse supposer n’est pas n’importe quoi puisqu’il a fait des centaines de milliers de morts en Amérique Latine.
Nous voici donc dans la quasi-actualité avec le ‘Mu’ (la lettre m), numéro 1.1.621 ou variant (ex-)colombien. Et ensuite? Eh bien, en grec comme en français, après le ‘m’ vient le ’n’. Malheur, ça se dit…NU, ce que, dit-on, plusieurs oreilles officielles francophones bien-pensantes (mais mal-entendantes) ne sauraient prononcer sans frémir. Le B.1.1.529 s’appellera donc ‘Omicron’ (dites omicronn) comme vous le savez (3), ce qui permettra d’éviter au peuple d’entendre cette syllabe très sensible puisque, visiblement, son virus est potentiellement plus contaminant que les précédents, y compris semble-t-il intellectuellement. Il parait même que la lettre ‘Xi’, normalement présente entre nu et omicron, ait été évitée pour ne pas déplaire au camarade Jingping (4)…on ne peut pas faire plus politiquement correct!
Alors, fantasme ou réalité? Au début d’un 21ème siècle éduqué et civilisé, les services d’immatriculation automobile de plusieurs préfectures avaient bien reçu des réclamations de conducteurs refusant une plaque QQ, PQ ou PD (il y a des contaminations partout!)…Dernier petit détail orthographique, si l’on veut être complètement précis: il y a en grec un ‘o’ court (un petit o, soit: o-micron) par opposition au ‘O’ long (ou un gros O, soit O-méga). Même si ce petit est costaud, on ne souhaite évidemment pas que la litanie des références morbides à ce virus continue sur la planète, mais nous avons quand même de la chance: en grec, « pi » (la lettre P) est directement suivie par « rho » (R); alors qu’en français, impossible d’oublier le Q…
PS: Au fil du temps, il semble que la prononciation (erronée donc) ‘omicraun’ se propage sur quelques plateaux télé. Au grand dam de quelques invités qui entendent un…O’Macron qui n’a rien d’irlandais!
- Sauf si on a la tête de mule de Donald Trump.
- Là, par contre, gros bug de ‘com’; la pathologie en question est bien du féminin; à moins que vous ne parliez de le rougeole, le coqueluche ou que nous n’ayez attrapé le grippe.
- On a donc sauté le nu…
- Un virus chinois ça va, deux bonjour les dégâts!


















